«Priver les élèves des grands textes de la littérature, c’est les priver de leur identité»
«Priver les élèves des grands textes de la littérature, c’est les priver de leur identité»
Interview de Barbara Lefebvre* accordée à Alexandre Devecchio, «Le Figaro»
Si la faillite de l’école est devenue un marronnier éditorial, le dernier livre de Barbara Lefebvre dépasse largement ce constat. A travers «Génération ‹J’ai le droit› – la faillite de notre éducation» (Albin Michel), l’essayiste et professeur dans le secondaire aborde des enjeux tels que la démission des familles, la dérive multiculturaliste de notre modèle d’assimilation ou encore l’instrumentalisation politique de l’histoire. Et livre une réflexion puissante sur la crise de l’autorité qui mine notre société ultra-individualiste.
Lors de sa première année dans un collège en zone d’éducation prioritaire de Sarcelles, Barbara Lefebvre n’avait aucune appréhension. Mais sa passion de la transmission, son enthousiasme pour donner aux élèves le goût de l’histoire et les aider à comprendre le monde vont rapidement se fracasser contre le réel. «Le réel était ce que les déracineurs produisaient méthodiquement jour après jour en faisant croire aux petits profs de terrain comme moi qu’ils participaient à la grande œuvre républicaine. Nous n’étions que les petits employés de la grande machine à déraciner la culture et l’histoire du cœur et des cerveaux des nouvelles générations», écrit-elle.
«Génération ‹J’ai le droit›» est le récit à la fois lucide et rageur de cette désillusion en même temps qu’une méditation plus large sur la faillite d’un progressisme dévoyé en individualisme irresponsable.
L’essayiste, coauteur de «Les territoires perdus de la République» (Mille et une Nuits) et d’«Une France soumise» (Albin Michel), y conjugue avec brio témoignage personnel et considérations philosophiques. «Notre passion illimitée de la liberté individuelle adossée à celle de l’égalité transformée en égalitarisme aura conduit à l’effacement du ‹nous› au profit d’un ‹je› tout-puissant, revendicatif et péremptoire», analyse celle qui entend désormais se consacrer à l’éducation des enfants handicapés.
Le Figaro: Votre livre s’intitule «Génération ‹J’ai le droit›». Pourquoi ce titre?
Barbara Lefebvre: Ce titre fait écho à ce que j’entendais de la bouche de nombreux parents ou collègues déplorant la perpétuelle opposition à leur autorité de la part des enfants ou des élèves. Le «je» individualiste s’impose au «nous» de l’intérêt général. Dans cette vision toute-puissante de l’individu, non seulement l’autre n’existe que comme instrument pour satisfaire mes désirs, mais aucune autorité ne semble légitime pour m’imposer quoi que ce soit.
Que répondez-vous à ceux qui voient un progrès dans cette extension des droits individuels, notamment en matière de liberté?
Je précise que je distingue le respect des droits humains fondamentaux, qui s’impose à l’adulte à l’égard de l’enfant, et les revendications de droits particuliers en conflit avec le bien commun. Ceci étant posé, la liberté n’est pas la satisfaction absolue de ce que l’individu juge être son droit. De la même façon que le respect des minorités ne signifie pas l’octroi de droits particuliers qui les sépareraient du corps social. La passion illimitée de la liberté, qui caractérise la civilisation occidentale depuis la Renaissance, a conduit à l’épanouissement de l’individu. Mais il y a un gouffre entre la reconnaissance de la singularité de l’être humain, dont témoigne par exemple l’œuvre de Montaigne, et l’individualisme puéril de notre époque. C’est l’individu-roi qui veut «vivre sans temps mort et jouir sans entraves», pour reprendre un célèbre slogan de Mai 68. La liberté a ses limites et il revient aux adultes de les poser, de les incarner. Lorsque l’adulte se dérobe à ses responsabilités, l’incompréhension de l’enfant face à toute contrainte sociale conduit à une frustration perpétuelle, voire à la violence.
Cette révolution individualiste, que vous décrivez comme un changement de civilisation, s’est faite à l’école. Comment ce basculement s’est-il opéré? Qui sont les «démolisseurs de l’école»?
Ce sont les idéologues de la déconstruction de l’autorité institutionnelle au nom de la liberté dans son dévoiement libertaire et de l’égalité dans son dévoiement égalitariste et niveleur. Née avec la «Beat Generation» dans les universités américaines des années 1950, cette idéologie est devenue dominante deux décennies plus tard pour aboutir à notre politiquement correct libéro-libertaire. Cette doxa se voulait révolutionnaire, mais elle s’est parfaitement acclimatée à l’ultralibéralisme mondialisé et à l’identitarisme communautaire, deux fossoyeurs de notre modèle de civilisation. Les «démolisseurs» sont présents dans les rouages de l’Education nationale dès l’époque d’Alain Peyrefitte [ministre de l’Education nationale sous Georges Pompidou pendant Mai 68, ndlr.] et diffusent une vulgate pédagogiste joliment emballée dans un discours d’experts. Une armée de Monsieur Homais au service du progrès qui exerce son magistère. Ils n’ont cessé de répéter que l’autorité était synonyme d’autoritarisme et la culture une arme de la domination bourgeoise occidentale.
Pour vous, il s’agit donc d’abord d’une crise de l’autorité?
Pour une large part, oui. On a remis en cause l’autorité enseignante dans sa légitimité à s’exercer, celle que la société confère à une personne ou une institution. Dès lors qu’on délégitime le représentant d’une autorité, on autorise l’enfant ou l’élève à contester, à désobéir, à croire que c’est son droit de réattribuer l’autorité à un tiers selon lui plus légitime ou d’être son propre maître. L’enfant, de par son immaturité intellectuelle et affective, a besoin d’être guidé dans la quête de son autonomie et de sa liberté. Pour cela, on doit lui faire éprouver que la réalité du monde, ce sont des contraintes et des frustrations, et qu’un adulte véritablement libre les surmonte sans se sentir bafoué perpétuellement dans son droit! L’acte d’enseigner a été dépeint par certains comme un acte de violence sur l’élève en raison de sa verticalité. Mais, dans le cadre scolaire, l’autorité est l’inverse de la domination: l’objectif de l’enseignant est de transmettre des savoirs pour permettre à l’élève de s’autonomiser, de se détacher progressivement de cette autorité. Pourtant, on a convaincu parents et enseignants eux-mêmes que l’école était le lieu de l’arbitraire culturel et de la violence institutionnelle. Quand les enseignants intègrent cette récusation idéologique de leur autorité, ils ne perçoivent pas que cela met en péril le cœur même de leur mission, ni que les contenus de l’enseignement s’en trouvent aussi délégitimés.
Vous avez été élève au moment des expérimentations de la génération 68 et professeur à la fin des années 1990 …
La plupart de mes enseignantes avaient de l’expérience et pratiquaient un enseignement explicite. La vulgate sur l’autonomie de l’élève les laissait apparemment de marbre. J’ai appris à lire avec la méthode syllabique. Toute ma scolarité élémentaire, j’ai eu des cours d’orthographe et de grammaire distincts des activités de lecture-compréhension ou de rédaction. Des devoirs, des conjugaisons ou des tables de multiplication à apprendre par cœur, des récitations de poésie classique, des livres à lire et non des extraits! Avec la plupart de mes maîtresses, c’était impunité zéro. On les vouvoyait; aujourd’hui, le tutoiement est l’usage courant. Quand je suis devenue enseignante, je ne me suis pas sentie tenue par le charabia pédago que l’IUFM [Instituts universitaires de formation des maîtres] cherchait à imposer. Pour moi, le discours de ces experts en «sciences de l’éducation» était l’expression vivante de la bêtise décrite par Flaubert: sérieuse au nom du progrès des masses, prétentieuse, qui établit des vérités sur le ton du dogme tout en se prétendant au service de l’esprit rationnel.
Vous avez fait vos premiers pas en ZEP à Sarcelles, Pierrefitte-sur-Seine et Colombes. Vous n’aviez alors aucun préjugé idéologique …
Non seulement je n’avais aucun a priori, mais je voulais enseigner dans ces établissements. Précisément parce que c’est auprès des élèves de milieux populaires, où l’accès à la culture classique est le moins usuel, que l’école doit œuvrer. Ce qui m’a immédiatement sauté aux yeux, c’était l’impunité dont bénéficiaient les élèves en termes de discipline ou de gestion de l’absentéisme par exemple. L’administration et certains collègues n’assumaient plus leur rôle d’adultes responsables. Tout se négociait. On achetait la paix sociale auprès d’une ou deux dizaines de caïds qui avaient pris le contrôle de la vie sociale de l’établissement. Il suffit d’une minorité qui exerce une pression continue pour obtenir la soumission de la majorité. J’étais atterrée d’entendre certains collègues ou responsables éducatifs minimiser des insultes racistes et antisémites, les comportements sexistes ou homophobes au nom de particularismes culturels: «C’est comme ça chez eux, que veux-tu y faire?» Cela, je n’ai jamais pu l’accepter. Je le vivais comme une insulte à la mission de l’école républicaine et un mépris pour la totalité des élèves et des familles qu’on condamnait à vivre sous le joug d’une minorité inculte et oppressive. On voit aujourd’hui comment cette minorité a imposé ses codes et ses principes ségrégatifs dans certains territoires. Ces territoires ont été perdus culturellement. C’était le sens de notre ouvrage en 2002, «Les Territoires perdus de la République» …
Vous insistez sur l’importance de la littérature dans la transmission de la culture. Peut-on enseigner les grands textes dans ces «territoires perdus de la République»?
On devrait pouvoir les enseigner mais, là comme ailleurs, on a rendu cet enseignement impossible, à l’exception de quelques établissements publics d’excellence. Dès le début de ma carrière, j’ai compris que le problème résidait d’abord dans l’apprentissage du français. Je l’évoque longuement dans le livre, car c’est central selon moi. L’illettrisme de masse est le produit de méthodes et de théories qui, sous prétexte d’«égalité des chances» et d’autonomie de l’élève, ont aggravé les inégalités comme le montrent nombre d’études. D’ailleurs, au lieu de remettre en question leurs méthodes d’apprentissage, ces experts ont préféré pathologiser les élèves en difficulté! L’acculturation actuelle est le résultat d’un non-enseignement de la langue française, car le pédagogisme a disqualifié un enseignement rigoureux de son orthographe, de sa grammaire, en noyant l’ensemble dans des approches théoriques désincarnées. Exit le passé simple et le plus-que-parfait. Près de 600 heures d’enseignement du français ont été perdues à l’école élémentaire depuis le début des années 1970, pendant que la linguistique transformait la grammaire scolaire en un jargon incompréhensible. De la même façon, on enseigne la littérature de façon technique et froide, comme s’il s’agissait d’une science. Il faudrait redonner aux élèves, dès le plus jeune âge, le plaisir de lire, mais c’est impossible quand vous n’arrivez pas à comprendre ce que vous déchiffrez. La France est une nation littéraire. Empêcher les élèves d’entrer dans la littérature, dans la compréhension de ses grandes œuvres, de Rabelais à Flaubert en passant par Racine ou Colette, c’est les priver de leur identité citoyenne. Je pense qu’on apprend à connaître et à aimer son pays par la fréquentation de ses grands auteurs. C’est même la singularité du destin identitaire français que d’être tout entier contenu dans sa littérature.
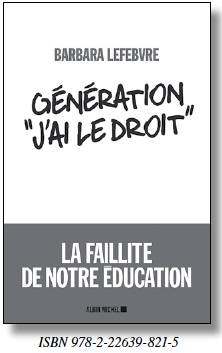
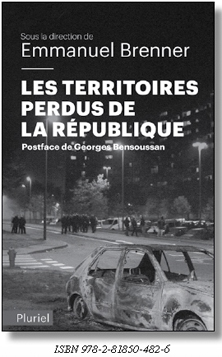
Vous êtes professeur d’histoire. L’enseignement de cette matière aurait, selon vous, été dévoyé à des fins idéologiques. Lesquelles?
L’histoire et son enseignement ont toujours été au cœur d’enjeux politiques et civilisationnels majeurs. Or, sur l’histoire scolaire comme dans l’enseignement du français, des clivages importants existent entre enseignants. Les médias caricaturent sous les traits de réacs nostalgiques ceux qui évoquent le «roman national». En fait, les historiens et militants «anti-réacs» sont des tartufes car ils savent que tout écrit historique est en soi un récit du passé. L’histoire est toujours à refaire, à réécrire. S’ils s’en prennent au «roman national» comme récit accumulant les clichés, c’est qu’ils veulent le remplacer par un autre roman national ou plutôt post-national. Leur discours prétend penser la complexité de l’histoire dans une vision binaire: dominants/dominés, bourreaux/victimes, vainqueurs/vaincus. La vision téléologique de l’histoire n’est absolument pas la mienne, qui n’est ni au service du progrès ni au service d’une utopie. Quand on enseigne l’histoire, on n’enseigne pas une métaphysique mais une représentation non dogmatique du passé. L’histoire scolaire doit être rigoureuse dans ses contenus, mais n’a pas vocation à faire partager aux élèves les tâtonnements de la recherche. Elle doit contribuer à faire d’eux de futurs citoyens ayant en partage une culture et une histoire communes. Or le commun est disqualifié puisque l’histoire scolaire est l’otage des identités et des mémoires qui clament chacune leurs droits dans une concurrence effrénée, parfois radicale.
Que pensez-vous de la nomination de Jean-Michel Blanquer à l’Education nationale? Un ministre peut-il remporter seul la bataille de civilisation qui se joue à l’école?
Un ministre ne peut pas tout. Combien de temps occupe-t-il le poste? Mais il peut beaucoup par la parole qu’il porte et les conseillers dont il s’entoure. On en a vu les effets calamiteux avec Najat Vallaud-Belkacem. Je pense qu’il y a une volonté, chez M. Blanquer, de redonner à l’école le sens de sa mission: transmettre des savoirs exigeants d’un point de vue culturel et scientifique dans un cadre enfin sécurisant pour tous les élèves. Il y a beaucoup à faire, notamment dans la formation des enseignants. Xavier Darcos [ministre de l’Education nationale de 2007–2009, ndlr.] avait cette ambition en 2007, mais sans le soutien de l’exécutif de l’époque. J’espère qu’il n’en sera pas de même pour M. Blanquer quand il attaquera dans le dur et que la vindicte pédago se déchaînera. Il y a des gens, à l’Education nationale, qui n’ont pas intérêt à voir le système se transformer! Il devra lutter contre ce conservatisme qui se prétend progressiste. Et je pense qu’il est en phase avec un grand nombre d’enseignants qui, eux, sont sur le terrain, et de parents qui ont envie de reprendre confiance en l’école de la République. •
Source: © Alexandre Devecchio, «Le Figaro» du 19/1/18