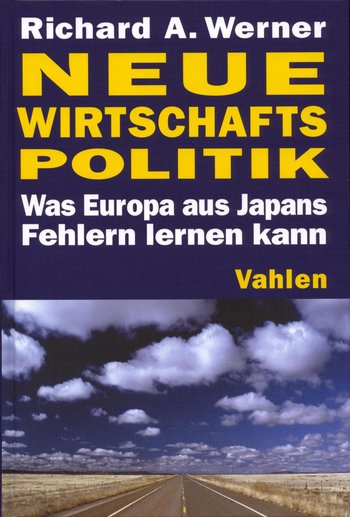«Il n’y a qu’une économie réaliste qui soit capable de trouver la solution des problèmes du monde où nous vivons»
Refléxions sur le livre «Neue Wirtschaftspolitik» de Richard A. Werner par Dieter Sprock, Suisse
von Dieter Sprock
Si nous partons du principe que les problèmes économiques et sociaux du monde ne sont pas issus du plan d’un «esprit du monde», quel qu’il soit, mais qu’ils sont le fait de l’homme, nous voilà donc devant la tâche de nous attaquer à ces problèmes et d’en chercher des solutions. Le manuel de l’économisteRichard A. Werner, intitulé «Neue Wirtschaftspolitik. Was Europa aus Japans Fehlern lernen kann» (Nouvelle politique économique. Ce que peut apprendre l’Europe des erreurs du Japon) et publié en 2007 déjà, propose une contribution essentielle. L’auteur examine dans quelle mesure une économie erronée a contribué à la propagation des maux économiques, tout en appelant à une économie réaliste et défendant le principe que seule une économie réaliste sera capable de contribuer à la solution des problèmes du monde où nous vivons.
Dans ma contribution, j’essaierai de présenter certaines des conclusions de ses travaux, en particulier celles qui me semblent importantes en vue d’une meilleure compréhension des processus économiques et politiques actuels. Ce faisant, je suis conscient que ma sélection ne reflète qu’une petite partie du très vaste matériel, d’autant plus que je n’entre pas dans les détails de la discussion matérielle (fachliche Diskussion) sur les diverses théories économiques, qui forment, bien sûr, une partie considérable du manuel.
Pour Richard A. Werner, les sciences économiques traversent une crise profonde. Les théories macroéconomiques sur lesquelles elle se fonde, constituant la base des décisions de politique économique dans de nombreux pays, relèvent, selon lui, «davantage de la fiction que de la réalité». Pour l’auteur, leur credo selon lequel le «pouvoir effectif des marchés libres» avec le moins d’intervention possible de l’Etat serait le meilleur moyen de parvenir à la stabilité économique et à la prospérité ne s’est pas avéré exact. Pendant des décennies, la conviction néolibérale a été mise en œuvre dans le monde entier, notamment dans les pays en développement et les anciens pays communistes, mais les résultats positifs escomptés ne se sont pas matérialisés: la pauvreté, le manque de sécurité sociale et l’inégalité économique restent un problème majeur pour la majorité des êtres humains. (p. VII)
L’économie néoclassique
«Privatisation, déréglementation et libéralisation», voilà le credo de l’école de pensée du néo-libéralisme que Werner traite sous le nom moins familier d’«économie néoclassique».
Selon la doctrine néoclassique, seul le marché libre permet «la prospérité, une économie florissante et un bonheur personnel maximal». Elle préconise que les entreprises dans lesquelles l’Etat détient sa participation soient vendues. Le marché du travail doit devenir plus «flexible», aboutissant à davantage de licenciements et une plus grande insécurité pour les employés. Des réformes de la sécurité sociale et des soins de santé sont exigées parallèlement. Les réglementations et interventions de l’Etat et de la société dans la circulation des capitaux, des biens et des personnes doivent être réduites autant que possible, et la régulation de toutes les activités économiques doit être entièrement abandonnée à la seule «main invisible» du marché.
Dès le milieu des années 1980, les débats sur les questions économiques et sociopolitiques étaient dominés par la pensée néoclassique, «dans tous ses aspects, qu’il s’agisse du rôle de l’individu, des préoccupations communautaires, des entreprises, de l’Etat ou même de la communauté internationale». (p. 3) L’économie néoclassique repose sur l’hypothèse selon laquelle «le but premier et le motif dominant de l’humanité est l’accroissement de la richesse matérielle» tandis que «les relations sociales et le besoin des individus d’entrer en relation les uns avec les autres et de trouver une reconnaissance dans la communauté», sortent entièrement du champ de vision du modèle néoclassique. (p. 20)
Dans les années 1990, l’influence de l’école de la pensée néoclassique est devenue omniprésente. La plupart des cours d’économie enseignaient exclusivement les doctrines du néoclassicisme ses représentants ayant accès aux plushautes fonctions publiques: «L’économie néoclassique a dominé les décisions des principales organisations internationales concernées par la politique économique. Les banques régionales de développement, le FMI, la Banque mondiale, la Banque des règlements internationaux (BRI), l’OMC (et son prédécesseur [le GATT]) ainsi que l’OCDE en figurent parmi les plus importantes.» Dans plus d’une centaine de pays, «les politiques des banques centrales, les programmes d’ajustement structurel, menés par le FMI, et les lots de réformes élaborés par les banques de développement ont entraîné des changements radicaux dans les politiques fiscales et monétaires». La ligne néoclassique était toujours suivie de rigueur – généralement avec le soutien du Trésor américain. (p. 5)
Théorie et réalité du néoclassicisme
à travers l’exemple du Japon
A l’encontre de cela, le Japon et les autres pays d’Extrême-Orient n’ont pas construit leurs économies modernes sur la base de la théorie néoclassique. Ils ont développé une forme de capitalisme dans laquelle les mécanismes du marché avaient toute leur place, il est vrai, mais qui veillait en même temps à ce que la société dans son ensemble, et non pas les actionnaires, soit le bénéficiaire du système. Ils étaient guidés par des théories que l’on pourrait classer comme appartenant à l’«école allemande historique» ou à l’«économie sociale».
Jusqu’à la fin des années 1980, l’économie japonaise d’après-guerre s’est appuyée sur un grand nombre de réglementations étatiques sous la forme d’un «pilotage économique» de l’Etat: les marchés des capitaux étaient limités, les «actionnaires» avaient peu d’influence sur les entreprises de l’économie productive et le marché du travail était «inflexible». Dans les grandes entreprises, les personnes occupant un emploi définitif bénéficiaient d’une garantie d’emploi à vie. L’avancement de leur carrière dépendait de leur ancienneté, ce qui entraînait une grande loyauté des employés envers leur entreprise. En plus, il y avait un grand nombre de «cartels» formels et informels: il s’agissait d’associations industrielles composées de nombreuses entreprises liées par des contrats à long terme et une confiance mutuelle, ainsi que de jusqu’à 1 000 véritables cartels approuvés «par exception» dans les années 1950 et 1960.
Le Japon a connu un taux de croissance moyen du PIB réel de 6,3 % entre 1950 et 2000 (malgré dix années de grave récession depuis 1991), soit près de deux fois celui des Etats-Unis et près de trois fois celui du Royaume-Uni. (p. 127) Or, selon la théorie néoclassique, l’économie japonaise aurait dû être «en pleine ruine» pendant cette période.
Le Japon et d’autres grandes économies d’Asie de l’Est ont en effet atteint une croissance économique élevée pendant des décennies, et cela sans bénéficier des «avantages des marchés libres», tandis que de nombreux «élèves modèles du FMI», en Afrique et en Amérique latine, qui avaient misé sur les marchés libres, gisaient dans une «pauvreté abjecte». (p. 8)
Après avoir frappé les économistes néoclassiques pendant des décennies par son énorme croissance, l’économie japonaise est inexplicablement tombée dans une profonde récession au début des années 1990. Le chômage a monté en flèche pour atteindre plus de 3,8 millions de chômeurs officiellement enregistrés à la fin des années 1990. Plus de 210 000 entreprises ont fait faillite. Cela a entraîné d’«immenses chocs sociaux» et laissé une «montagne de créances douteuses». Chaque année, quelque 30 000 personnes mettaient fin à leurs jours. (p. 10) L’ampleur de la crise avait dépassé de loin ce que l’on entend conventionnellement par une récession cyclique.
Toutes les mesures de politique économique, comme la baisse des taux d’intérêt ou l’augmentation des dépenses publiques, qui, selon la théorie néoclassique, auraient dû stimuler l’économie, ont été inefficaces: les taux d’intérêt à court terme sont passés de 6 % en 1991 à 0,001 % au début de 2004, et les taux d’intérêt à long terme, d’une durée de dix ans, de plus de 7 % à 0,4 %. L’inefficacité de la politique de taux d’intérêt avait suggéré le recours à des «mesures de relance budgétaire» pour assurer la sécurité sociale du pays. En 2002, la dette nationale a atteint le niveau record de 150 % du produit national brut annuel. Mais les succès escomptés ne se sont pas matérialisés. La crise a duré plus de dix ans.
«L’économie traditionnelle, dit l’auteur, a été mise à l’épreuve par le fait que ni une décennie de baisse des taux d’intérêt à des niveaux records ni une décennie d’expansion budgétaire n’ont aidé l’économie japonaise à se remettre sur pied.» Il est juste d’affirmer, écrit Werner, que la théorie et la réalité divergent pendant un an ou deux. En revanche, plus d’une décennie de sous-performance flagrante malgré des mesures de relance exemplaires ont révélé la défectuosité de la pensée mainstream. (p. 11)
Le rôle de la Banque du Japon
Dans le manuel de Richard A. Werner, l’étude de la crise économique japonaise occupe une place centrale, il en conclut que la responsabilité de la crise incombe directement à la Banque du Japon. Non seulement la Banque du Japon a trompé le public sur les politiques qu’elle menait, mais elle a également fait fi de la fonction de surveillance du ministère des Finances. (p. 384) Elle avait «continuellement abaissé les taux d’intérêt, présumément en accord avec ses assurances zélées qu’elle faisait tout son possible pour provoquer une reprise économique», alors qu’en fait elle pratiquait «une politique monétaire extrêmement restrictive», prolongeant ainsi artificiellement la crise. (p. 423) Elle a poursuivi ainsi des objectifs «conformes à son propre credo politique qui a servi à mettre en œuvre des changements structurels au Japon et à créer des faits favorisant la déréglementation, la libéralisation et la privatisation». (p. 414)
Les bases de la récession avaient déjà été posées par la Banque du Japon dans les années 1980 en «imposant aux banques commerciales des ratios de croissance du crédit excessifs». En une décennie de prêts excessifs, le Japon était devenu «la puissance dominante sur les marchés financiers mondiaux». Les investisseurs japonais ont réalisé des transactions immobilières et des acquisitions d’entreprises dans le pays et à l’étranger. «Dans le monde entier, des actifs financiers et réels de toutes sortes, y compris des œuvres d’art et des trésors similaires, semblaient être la cible des acheteurs japonais.» Les prêts bancaires expansifs ont fait grimper le prix des actifs sur les marchés immobiliers et boursiers jusqu’à ce que la bulle spéculative éclate en 1991 et que le château de cartes s’effondre en l’espace d’un quart d’année. (p. 180)
Pendant la crise, des milliers de mesures de déréglementation ont été imposées, ce que les Etats-Unis avaient déjà exigé dans les années 1960 lors des négociations d’un accord commercial: des réformes administratives ont été introduites, la libéralisation des marchés financiers décrétée et les cartels démantelés. Mais les performances économiques du Japon se sont affaiblies à mesure qu’il s’éloignait de la structure traditionnelle de l’après-guerre pour se rapprocher du «capitalisme actionnarial à l’américaine». «Au fur et à mesure que le capitalisme actionnarial à l’américaine s’est répandu, écrit Werner, les inégalités de revenus et de richesses ont augmenté. Non seulement le taux de suicide a augmenté de façon marquée, mais les crimes violents aussi.»
Si l’on inclut les effets sociaux dans le tableau, il ne fait aucun doute que le déclin des performances de l’économie japonaise a été encore plus important et plus lourd de conséquences que ne le suggèrent les simples chiffres attestant de l’effondrement du taux de croissance du PIB. (p. 133)
Sur la nature
de la monnaie et des banques
«Les transactions bancaires», écrit Werner, sont «une partie indispensable des activités économiques de l’humanité depuis des milliers d’années». (p. 212) Ils sont plus anciens que la monnaie fiduciaire. Les banques étaient répandues en Mésopotamie dès le troisième millénaire avant notre ère. Les services bancaires étaient également le «cœur» de l’économie antique. «Les représentants des banques sont devenus des sénateurs influents, et les sénateurs étaient actifs dans le secteur bancaire.» (p. 211) Entre le troisième et le sixième siècle de notre ère, les orfèvres ont rempli la fonction de banques en Europe et, là encore, les dynasties bancaires ont toujours été étroitement liées à la politique et à l’économie. Les banques étaient la cheville ouvrière de toute économie, toutes les transactions non monétaires passant par les banques. Mais elles ne sont pas seulement les «comptables» de l’économie, elles fournissent également à l’économie de l’argent frais, qu’elles sont autorisés à créer à partir de rien en prêtant, et elles décident de l’allocation de l’argent et donc des secteurs de l’économie qui se développent et de ceux qui ne le font pas. Cela leur confère un pouvoir de formation et une puissance énorme. Comme le montre l’exemple du Japon, elles sont également capables de créer des crises, de les exacerber et de les prolonger.
«La fonction des banques, écrit Werner, n’était en aucun cas limitée aux activités de dépôt et de prêt. Leurs compétences englobaient également le commerce, l’exploitation minière, les activités manufacturières et la perception des impôts (octroi du droit de percevoir des impôts et d’en retenir les surplus). Les banques ont financé les gouvernements et leurs diverses interventions militaires.» (p. 210) En raison notamment de leur caractère de «nerf de la guerre» (leur rapport direct à la guerre) elles ont joué un rôle décisif dans le cours de l’histoire mondiale. (p. 212)
Les conflits militaires continuent de tenir le monde en haleine. En dépit de toutes les divergences intervenues dans les circonstances du déclenchement de ces mêmes conflits, on relève cependant des points communs à tous: «Les conflits armés trouvent souvent leur origine dans les inégalités économiques; les rivalités pour des ressources naturelles limitées – qu’il s’agisse d’eau, de pétrole, de matières premières ou de terres fertiles – jouent un rôle majeur. A l’origine des conflits armés, les raisons économiques n’ont jamais fait défaut.» (p. 21)
Des fonds et des devises
générés – à partir de rien
Ce à quoi les alchimistes du Moyen Age n’étaient jamais parvenus, c’est-à-dire à fabriquer de l’or à partir du plomb, les banques y sont arrivées grâce à leur capacité à créer de l’argent à partir de rien et en percevoir les intérêts et les intérêts composés.
L’activité consistant à prêter avec intérêts et intérêts composés est extraordinairement rentable et, par rapport aux autres industries produisant de nouveaux biens, elle nécessite peu d’efforts. Si, par exemple, quelqu’un contracte un prêt temporaire de 100 000 euros à un taux d’intérêt annuel de 8 %, il aura au bout de dix ans remboursé 221 964 euros; et au bout de 30 ans, le total des remboursements atteindra déjà 1 093 573 euros. (p. 216) Le baron Rothschildaurait décrit le mécanisme de l’intérêt composé comme «la huitième merveille du monde».
Mais ce qui rend les banques et les banques centrales vraiment extraordinaires, c’est leur capacité à créer de l’argent ex nihilo, à partir de rien. Bien que – comme c’était encore le cas avant la création des banques centrales– les banques commerciales n’émettent plus elles-mêmes de billets de banque, l’octroi de prêts est resté à ce jour leur activité principale.
Cependant lorsqu’on accorde un crédit, on ne détourne pas des fonds déjà existants vers de nouvelles utilisations, mais on crée de nouveaux fonds qui n’existeraient pas sans le crédit. «Les banques créent de l’argent à partir de rien.» Le débiteur reçoit un «certificat de dépôt fictif» ou une inscription correspondante sur son compte, alors qu’il n’a en réalité effectué aucun dépôt ou alors seulement un versement bien plus modeste. (pp. 220-221). A cette fin, la banque utilise une «comptabilité créative» en créant une «fiction comptable» en vertu de laquelle tout se passe comme si l’emprunteur avait vraimentdéposé les fonds correspondants. (p. 230)
La capacité de générer du crédit ou des fonds – les deux termes sont considérés comme étant synonymes – explique pourquoi les banques ont si rapidement accumulé des richesses et acquis de l’influence au cours de l’histoire. Elle fournit «la clé qui explique pourquoi les banques ont pu occuper des positions de premier plan dans divers secteurs de l’économie, fonder des entreprises et des industries entières, et les dominer– le plus souvent en les rachetant». L’autorisation d’émettre des devises pourrait dans certains cas faciliter la vie, estime Werner. (p. 231)
Création monétaire par l’Etat
Au fil de l’histoire, les Etats ont également fait usage à plusieurs reprises de la possibilité de créer eux-mêmes de la monnaie afin de financer les dépenses publiques. Ce système présentait l’avantage d’éviter de contracter des dettes qui nécessiteraient le paiement d’intérêts et d’intérêts composés. En effet, dans la plupart des pays industrialisés, notamment aux Etats-Unis et au Japon, il existe un passif considérable en raison de l’effet des intérêts composés, de sorte que ce sont des générations de contribuables qui doivent rembourser les dettes précédemment contractées.
Thomas Jefferson ( 1743–1826), troisième président des Etats-Unis, était un adversaire déclaré des banques centrales privées. Sous son administration, la Constitution américaine autorisa explicitement le gouvernement à émettre lui-même sa monnaie. Mais depuis la création de la Réserve fédérale en 1913, qui aujourd’hui encore est une entreprise privée, on assiste à un éloignement croissant de cette voie empruntée par Jefferson. De ce fait, les Etats-Unis se sont retrouvés lourdement grevés par une dette nationale considérable et le service de la dette qui lui est associé. Aujourd’hui, le système bancaire et les banques de la Réserve fédérale – toutes privées – exercent le monopole de la création de crédit aux Etats-Unis.
L’un des rares présidents à avoir remis en question ce système monopolistique a été John F. Kennedy. Par le décret présidentiel n° 11 110 – l’un des tout derniers de son mandat – il a décrété en 1963 l’émission de «United States notes», des billets de banque officiels mis directement en circulation par le Gouvernement et qui étaient visuellement pratiquement identiques aux «Federal Reserve Notes» bien qu’ils n’aient rien à voir avec l’institution privée qu’était la Réserve fédérale.» Après la mort de Kennedy, cependant, aucun président n’a plus eu le courage de faire appliquer son décret présidentiel. (pp. 332 et suivantes)
Autre exemple, apparu au 13e siècle en Chine: le papier-monnaie. Le Livre des voyages, les mémoires du négociant vénitien Marco Polo (1254–1324) longuement citées par Werner, montre l’habileté avec laquelle le souverain mongol Kubilaï Khan (1215–1294) avait fait émettre ce moyen de paiement avant d’imposer son adoption dans tout l’Empire mongol. Le papier-monnaie ne reposait pas sur une garantie-or. Bien au contraire, c’étaient les marchands eux-mêmes qui apportaient à l’empereur «des perles, des pierres précieuses, de l’or, de l’argent et d’autres objets de valeur» et les échangeaient contre les billets de banque grâce auxquels ils pouvaient tout acheter et payer. L’empereur, en augmentant ou en réduisant le flux monétaire, pouvait ainsi contrôler la conjoncture de l’économie à volonté (voir encadré: le papier-monnaie chinois).
Investissements étrangers
Pour relancer et développer leur économie, les pays économiquement faibles et ceux que l’on appelle les pays en voie de développement misent sur les investissements étrangers directs. Toutefois ces derniers, alerte Werner, s’accompagnent souvent de considérables inconvénients: d’une part, les investisseurs étrangers ont leurs propres intérêts, qui le plus souvent ne concordent pas avec ceux des pays en développement concernés. D’autre part, ceux qui sont en possession des «actifs réels» ont également le «pouvoir de disposer» de la répartition des bénéfices, de la fermeture des installations de production ou du retrait effectif des pays étrangers. «Pourquoi donc, demande Werner, aller s’endetter à l’étranger, payer les intérêts et le principal, alors que vous pouvez tout aussi bien générer chez vous et gratuitement les moyens [de mobiliser les ressources nationales]? Après tout, les banques étrangères ne font rien d’autre que cela: elles émettent des devises ‹à partir de rien› par le biais du processus de création du crédit.» (p. 280)
La nécessité d’une nouvelle
politique économique s’impose
Le modèle économique néoclassique avait sa chance, dit l’auteur, d’aider le monde à faire de réels progrès, mais il a échoué et prouvé que les «marchés libres» étaient incapables de créer un meilleur équilibre social dans le monde réel. Il serait donc temps, insiste-t-il, de mettre en place un nouveau type d’économie.
Le néoclassicisme parle de la «concurrence» comme d’un «mécanisme clé». Mais dans la réalité, le marché est beaucoup moins important pour le soi-disant «capitalisme de marché» qu’on ne le croit généralement. Les solutions économiques ne sont en fait «pas négociées sur les marchés, mais décrétées par les adjudicateurs [banques d’investissement et autres grands investisseurs]». (p. 437)
La majeure partie de l’activité économique mondiale est contrôlée par quelques grandes banques, qui à bien des égards sont plus puissantes que les gouvernements. Elles contrôlent l’émission et la distribution du crédit mais ne sont pas soumises à un contrôle démocratique direct, ce qui constitue une menace majeure pour la démocratie.
La politique monétaire est le moyen le plus efficace d’atteindre des objectifs macroéconomiques. Elle ne se contente pas d’influencer la croissance économique, mais elle est aussi capable de provoquer des changements sociaux. «Du fait du pouvoir considérable et de la portée de la politique monétaire dans le contrôle et le management des ressources économiques nationales, elle devrait être confiée à une institution fermement ancrée dans le processus démocratique – comme le Ministère des Finances, par exemple.»
Comment est-il possible, s’interroge Werner, que la politique budgétaire, sans rapport avec la croissance, soit débattue au Parlement, mais pas la politique monétaire, elle qui détermine à la fois la croissance et qui sert à la redistribution et à la politique structurelle? (p. 451)
La politique budgétaire – toutes les mesures qui ont trait aux recettes et aux dépenses des budgets publics, notamment les impôts, ou même l’émission de bons du Trésor – est «sans incidence sur la croissance». Pour cette raison, il convient de n’y avoir recours qu’avec la plus grande modération. Il s’agit exclusivement d’un instrument de redistribution.
«Afin d’éviter les éventuelles pertes de bien-être nettes qui résultent d’une dette publique inutile et de charges d’intérêts non-économiques, il faudrait avoir à cœur le principe d’un budget équilibré», insiste Werner. (p. 450)
La première étape de la mise en place d’un nouveau paradigme macroéconomique devrait donc être de subordonner le pouvoir de décision en matière de création de crédit et sa répartition sociale à des contrôles démocratiques et de chercher à mettre en place une politique économique qui produirait de meilleurs résultats, plus équilibrés sur le plan social, que les approches dominantes actuellement en vigueur. (p. 454) Pour ce faire, il est particulièrement urgent de contrôler les banques centrales.
Mais dans le même temps, Werner recommande la prudence en la matière: une intervention maladroite de la part d’inaccessibles instances étatiques ne serait guère couronnée de succès. L’Etat doit veiller à accorder aux individus une liberté d’action maximale et à limiter la portée de ses interventions directes aux seules occasions absolument indispensables. L’intervention serait surtout nécessaire dans le cas où l’émission de crédits serait utilisée à des fins improductives et financerait des opérations spéculatives dans le secteur immobilier, l’acquisition de fonds spéculatifs ou encore des opérations de rachat. Afin d’éviter la formation de bulles spéculatives et de prévenir l’inflation, il faut utiliser la masse monétaire à des fins productives et génératrices de revenus.
Werner évoque l’exemple japonais de forte croissance, mais appelle également à de nouvelles recherches dans ce domaine. Selon lui il serait donc essentiel que la recherche se consacre de manière beaucoup plus intensive à l’élaboration d’institutions appropriées, de systèmes d’incitation appropriés et s’intéresse au comportement réel des individus – «un vaste domaine de la plus haute importance pour la justification théorique et la réalisation pratique des principes d’un ordre juridique et économique». (p. 451)
Toujours selon les écrits de Werner, un gigantesque programme de recherche se déploie devant quiconque s’engage sur la voie d’un nouveau type d’économie. Ce dont nous avons besoin, c’est du courage de repenser, de débattre et de mettre en application une économie véritable, pratique et basée sur la réalité.
Additif
Treize ans se sont écoulés depuis la publication de ce document. Je pense qu’il n’a rien perdu de son actualité. Un premier ouvrage, plus ancien, de Werner, «Princes of the Yen»(«Les maîtres du Yen»,Quantums-publishers.com) et qui a été un best-seller au Japon, sera publié en allemand cette année.
Actuellement, un nombre croissant d’observateurs constate que se creuse davantage le fossé entre pays riches et pays pauvres, ainsi qu’entre riches et pauvres au sein d’un même pays. La pandémie du coronavirus semble avoir renforcé cette tendance.
Il ne se passe pas de jour sans qu’à la rubrique Economie des journaux on ne parle d’un crash possible ou déjà imminent. Les prix des actions ou des biens immobiliers ont atteint des sommets irréalistes– tout comme cela avait été le cas avant la récession japonaise– et continuent d’augmenter malgré la crise. L’argent afflue dans l’industrie financière et non dans l’économie réelle.
Le marché boursier se dégrade et tourne au casino. Et un nouveau système monétaire informatique est déjà en préparation sous la forme de«crypto-monnaies». Autant de raisons pour donner la priorité à la recherche d’une «nouvelle politique économique».
«Nous avons d’excellentes raisons de façonner les économies de manière à accorder une plus grande place aux comportements coopératifs; il nous incombe d’établir une forme de capitalisme socialement acceptable qui aurait pour objectif le bien-être de tous, et dans le cadre duquel chacun serait considéré comme un être humain de qualité», écrit Richard A. Werner. (p. 450)•

(photo mad)
hd. Richard A. Werner est un économiste et professeur d’université allemand. Après avoir obtenu un diplôme à la London School of Economics et un doctorat à l’université d’Oxford, il a enseigné, entre autres, à la Sophia University de Tokyo, à l’université de Southampton (Angleterre), à la Goethe-Universität de Francfort et à l’université Corvinus de Budapest. Il est actuellement professeur de finance à l’université Fudan de Shanghai et professeur de sciences et techniques bancaires et financières à la De-Montfort University de Leicester (Angleterre). Il a en outre acquis une solide expérience dans le secteur financier, notamment en tant qu’économiste en chef de la banque d’investissement britannique Jardine Fleming Securities (Asia) à Tokyo, en tant que consultant principal de la Banque asiatique de développement à Manille et en tant que directeur général principal de Bear Stearns Asset Managementà Londres. Son livre «Princes of the Yen» (Les maîtres du Yen), publié pour la première fois en japonais en 2001, a été classé numéro un sur la liste des best-sellers. En 1995, il a publié dans le journal financier japonais Nikkei son projet de nouvelle politique monétaire visant à mettre rapidement fin aux crises bancaires, projet qu’il a qualifié «d’assouplissement quantitatif» et qui a suscité l’intérêt de nombreuses banques centrales. Richard Werner est membre fondateur et membre du conseil d’administration de la Local First Community Interest Company, une société à but non lucratif qui procède, par ailleurs, à la mise en place de banques locales au Royaume-Uni sur le modèle des banques coopératives et des caisses d‘épargne allemandes.
Les billets chinois
«Les sites de production d’argent du Grand Khan se trouvent à Cambaluc. A les voir, on dirait que le Grand Khan connaît l’art de l’alchimie. Ce que je vais vous démontrer maintenant.
Le procédé de production est le suivant: on utilise l’écorce des arbres – des mûriers plus précisément – dont les feuilles sont la nourriture des vers à soie. On enlève le raphia fin entre l’écorce et le bois, l’émiette, et à l’aide d’une sorte de scotch de feuilles noires, il est étendu au rouleau comme du papier de coton. Ensuite, on coupe les feuilles en rectangles de tailles différentes. […] On met le cachet du Grand Khan sur tous les billets. La distribution est si officialisée qu’on croirait avoir affaire à des billets en argent ou en or. Chaque billet est signé par des fonctionnaires spécifiques qui mettent leur propre cachet. Une fois le procédé terminé selon toutes les règles, le fonctionnaire le plus haut placé du Grand Khan trempe le cachet et la bulle dans du vermillon et l‘appuie sur la partie supérieure du billet pour que la couleur du cachet en vermillon y reste.
C’est ainsi que les billets obtiennent leur validité. Quiconque osait les fausser, se verrait puni le plus sévèrement.
Le Khan en fait produire une énorme quantité, afin de pouvoir acheter les trésors du monde entier. Tout est payé avec cet argent: dans toutes les provinces, dans chaque royaume et dans tous les lieux où règne l'influence du Khan, ses billets sont le seul moyen de paiement. Dans le cas où quelqu’un s’y refuse, il est puni par la peine de mort. Cela étant dit, je vous assure que tout un chacun et tous les peuples du royaume sont contents de payer avec ces billets parce qu’ils sont valables partout: on peut acheter toutes sortes de produits, des perles, de l’or et de l’argent. Avec ces billets, on peut tout acheter et payer. Bien qu’ils aient la valeur de 10 Byzantins, ils n’en pèsent pas un seul.
Pendant l’année, il arrive souvent que des groupes de marchands qui viennent à Cambaluc offrent des perles, des pierres précieuses, de l’or et de l’argent ainsi que d’autres valeurs comme des tissus en or et en soie au Khan. Le Grand Khan appelle 12 fonctionnaires pour qu’ils examinent et estiment la valeur des produits et payent la somme adéquate. Ces douze fonctionnaires compétents examinent tout, fixent le prix et paient en billets d’argent comme bon leur semblent. Les marchands sont contents d’obtenir des billets car, ainsi, ils peuvent acheter ce qu’ils veulent dans tout le royaume tartare.
Voici la pure vérité: plusieurs fois par an, les marchands apportent des valeurs qui valent à peu près quatre cents milles Byzantins. Et l’empereur achète le tout en billets d’argent.
De temps en temps, le Khan ordonne à tous les habitants d’une ville possèdant des pierres précieuses, des perles, de l’or et de l’argent de les apporter aux sites de production et de les lui donner. Comme personne n’ose s’y opposer, il s’entasse des quantités de biens précieux qui seront payés en billets. Ainsi, le Khan réussit à amasser les matériaux et les pierres précieuses du royaume entier dans ses trésors. Tous les soldats sont payés avec ces billets d’argent.
Voilà pourquoi le Grand Khan dispose de plus de trésors que tous les autres. Et je peux vous dire que tous les puissantsréunis ne possèdent pas autant que le Khan à lui seul.»
Marco Polo, cité par Werner, p. 213 s.
(Traduction Horizons et débats)